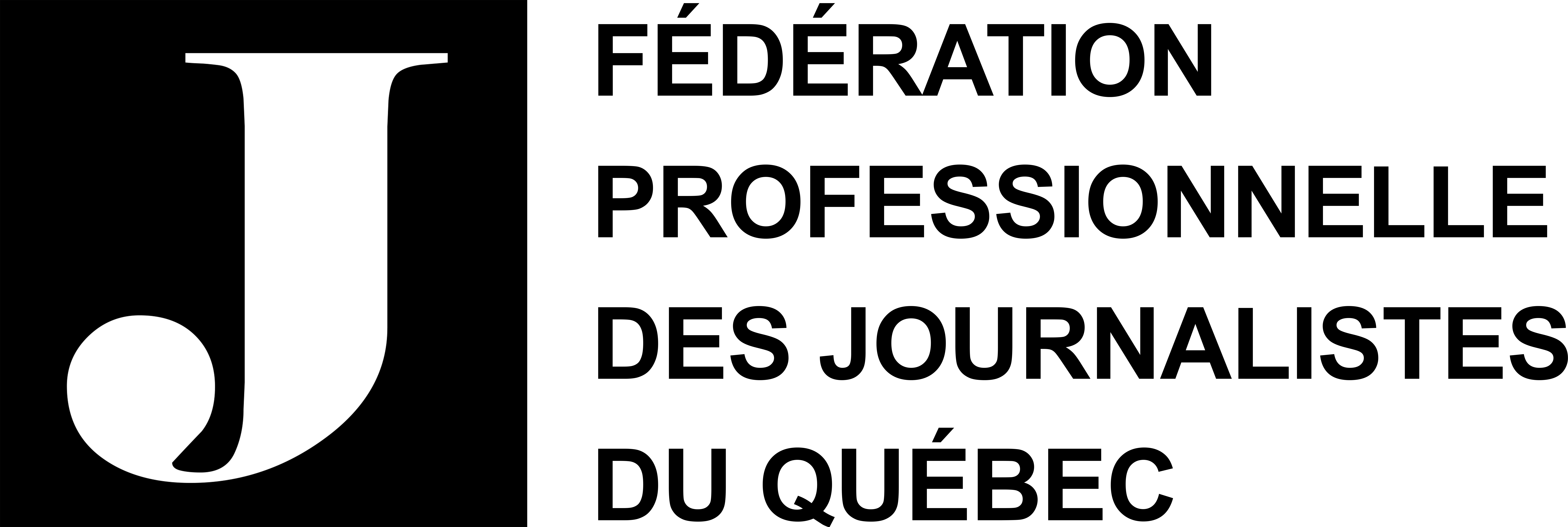Par Hugo Meunier
Les photojournalistes déplorent le manque d’accès au milieu hospitalier
« Je peux pas te parler maintenant, j’attends la sortie d’un corps devant l’hôpital, c’est le bordel ici. Il y a deux trucks de la morgue », m’explique au téléphone Allen McInnis, le vétéran photographe du quotidien The Gazette, sur le terrain depuis le mois de mars pour documenter la crise.
Comme lui, plusieurs de ses collègues sont au front depuis plusieurs semaines, souvent au péril de leur propre sécurité. Afin de jeter un peu de lumière sur le travail essentiel de ces travailleurs de l’ombre, j’ai voulu leur consacrer ce billet.
Mais ce qui se voulait au départ un coup de chapeau sympathique a pris une tournure inattendue lorsque tous les photographes contactés ont dénoncé d’une même voix le manque d’accès dans le milieu hospitalier et une forme de censure dont ils s’estiment victimes dans l’exercice de leur métier. Au moment de publier ce texte, le chroniqueur Stéphane Baillargeon déplorait aussi le manque d'images de l'intérieur.
Le photographe Ivanoh Demers de Radio-Canada (un ex de La Presse) illustre bien le problème. « Tout le monde parle des anges gardiens depuis des semaines, mais on ne les voit jamais. On ne veut pas déranger ces gens, mais simplement montrer leur réalité, de manière respectueuse », plaide le photographe, d’avis qu’il est crucial de documenter pour nous, pour notre mémoire collective.

Ivanoh Demers
Son camarade McInnis abonde dans le même sens. Comme tous les photojournalistes sondés d’ailleurs. « C’est la plus grosse histoire du monde et les portes nous sont fermées partout. On n’a rien ici pour documenter la crise. On va illustrer nos livres d’Histoire avec des photos des États-Unis et d’Europe », peste McInnis, qui avait marqué les esprits pour ses images dures prises entre les murs de Polytechnique après le carnage.
Avec une pointe de jalousie, les photographes ont salué le travail des photographes du New York Times et du Washington Post, qui ont récemment réalisé des reportages magistraux dans des hôpitaux aux airs de zone de guerre, en plus d’avoir amorcé de fascinantes réflexions au sujet de l’image au temps de la COVID-19. « C’est encore plus frustrant quand on voit ce qui se fait ailleurs. Je ne sais pas si c’est pour des raisons de sécurité ou la peur de nous avoir dans les pattes », s’interroge Marie-France Coallier du Devoir, également fidèle au poste sur le terrain depuis mars.
.jpg)
Marie-France Coallier
Quelques rares accès ont jusqu’ici été accordés à La Presse, d’abord au photojournaliste Martin Tremblay au CHSLD Villa val des Arbres et ensuite à son camarade Edouard Plante-Fréchette pour illustrer l’immersion en CHLSD de la chroniqueuse Isabelle Hachey.
Sinon, rien. Les médias doivent rivaliser d’ingéniosité pour « voir » les zones rouges de l’intérieur, avec des caméras GoPro ou en se faisant embaucher incognito une semaine comme l’a brillamment fait ma collègue Jasmine Legendre, avec des photos prises en catimini avec son cellulaire.

« On est justement là pour montrer le travail des gens dans les hôpitaux et montrer leur réalité. Faut-il se faire passer pour des bénévoles ou des préposées pour avoir des images ? », se demande avec justesse Patrick Sanfaçon de La Presse, qui déplore ce qui ressemble à ses yeux à un contrôle de l’information.
Cet accès limité aux zones rouges ne date pas d’hier fait remarquer le photographe de l’Agence QMI Joël Lemay, qui alimente les différentes plateformes de Québecor depuis le début. « J’étais à Mégantic en 2013 et il fallait tout faire avec des téléobjectifs tellement on était loin de la scène. C’est sûr que j’aimerais mieux une couverture complète. Là on a les anges gardiens, mais à travers une vitre », constate le photographe, qui se console en ayant une carte blanche totale pour illustrer la pandémie à sa manière. « J’ai peut-être eu 4-5 affectations depuis le début seulement. L’autre jour, je voulais un passant avec un masque devant un graffiti près d’un dépanneur dans Rosemont. J’ai attendu quatre heures pour avoir ma shot », raconte Joël, qui s’estime chanceux de pouvoir donner libre cours à sa créativité.

Crédit : Joel Lemay
Le besoin de couvrir
Aucun photographe à qui j’ai parlé ne s’est fait tordre un bras pour couvrir la crise. Au contraire. Pour mon ami et ancien partner Patrick Sanfaçon, c’est business as usual, lui qui patrouille la ville à bord de son camion converti en salle d’écoute mobile pour La Presse depuis 12 ans, cette fois avec la polyvalente journaliste Mayssa Ferah.
« On a vraiment l’impression de documenter l’histoire, il y a des rebondissements chaque semaine. Même si des gens vivent des situations très difficiles, c’est très enrichissant et intéressant d’un point de vue professionnel », admet-il, ajoutant qu'il faut prendre les mesures de sécurité qui s’imposent dans son travail. « Je ne ferais pas certaines de mes premières affectations de la même façon. Par exemple un topo à Sainte-Justine avec Tristan (Péloquin), où on faisait passer les premiers tests. « Toutes les infirmières portaient des visières et nous n’avions aucune protection. Je referais la job avec un masque mettons... », indique Patrick, dont les photos suscitent plus de réactions que jamais sur sa page FB personnelle. « Les gens sont plus sensibles, normal c’est le talk of the town. Je ressens de l’empathie pour notre travail aussi, mais c’est rien par rapport à ce que des gens vivent », nuance Sanfaçon, humble, ajoutant ne ressentir aucune pression de ses employeurs pour qu'il s’expose aux risques.

Crédit: Patrick Sanfaçon
Malgré sa feuille de route bien garnie, le légendaire Jacques Nadeau du Devoir a pour la première fois du mal à sizer la couverture actuelle. « Les gros évènements, on sait d’ordinaire que ça va finir par arrêter. Là, on en a absolument aucune idée, on est totalement dans le flou », constate Nadeau, qui salue la capacité des médias à se renouveler semaine après semaine. « Ce qui me touche le plus, ce sont les gens qui meurent seuls. La mort, c’est comme un saut en parachute et le faire seul sans personne qui nous donne la main, ça doit être très dur », philosophe le vieux routier, qui s’efforce de saluer les gens qu’il croise dans la rue pour combattre la morosité ambiante. « Tabarnak! Un gars court en maillot de bain ! », lance soudainement Nadeau au bout du fil, avant d’aller immortaliser la scène avec la passion qu’on lui connaît.

Crédit: Jacques Nadeau
Une cueillette perpétuelle
Ivanoh Demers aussi sillonne sans arrêt la ville en quête de photos. Une cueillette perpétuelle, qui se traduit par l'envoi d’environ une quarantaine de clichés par quart de travail. « Des dépouilles, des infirmières, des personnes âgées, la distanciation sociale : c’est vraiment un gros travail d’archivage », admet Demers, qui a notamment couvert en direct le séisme haïtien de 2010.
Malgré sa vaste expérience, il s’étonne chaque jour de découvrir sa ville sous un angle différent. « La basilique Notre-Dame vide, la station Berri-UQAM déserte : c’est banal mais ça va être des photos qui vont surprendre dans quelques années », explique Ivanoh, qui trouve aussi bizarre de s’habituer à photographier des personnes décédées sortir des CHSLD.

Crédit: Ivanoh Demers
Ivanoh est le seul qui m’a avoué avoir eu peur d’attraper le virus, une peur bleue même au début. « Là je me conditionne à me dire que je vais le pogner et j’espère que ça ne sera pas trop dur », résume celui qui malgré tout ne changerait de job pour rien au monde. « Si t’es pas sur le terrain présentement, t’as pas choisi le bon métier. »
Des mots qui trouvent écho chez Marie-France Coallier du Devoir. « J’aurais jamais pu rester à la maison. Il faut le vivre ! », s’exclame-t-elle, ajoutant n’avoir aucun mal à trouver ses sujets tellement la crise est « évolutive ». « Nos libertés sont brimées, l’accès est difficile mais on arrive toujours à trouver des moyens de travailler dans l’adversité », constate Marie-France, qui traîne un kit de survie complet dans sa voiture, incluant une toilette portative.

Crédit : Marie-France Coallier
Comme Patrick Sanfaçon, elle trouve paradoxal de vivre une certaine frénésie dans son travail alors que des gens meurent autour de nous. « Notre métier nous prépare à nous adapter. On est des humains, mais on devient conditionné », souligne celle qui a notamment couvert Polytechnique.
De son côté, Allen McInnis craint davantage les coupures qui frappent le milieu des médias que le virus. « Est-ce que j'aurais une paye à long terme dans ce métier ? », se demande-t-il, inquiet. En attendant, il continue à illustrer la crise pour The Gazette, comme il le fait assidûment depuis 30 ans. « Mon père était photographe avant moi, c’est toute ma vie », résume le vétéran.

Crédit: Allen McInnis
Joël Lemay aussi s’estime chanceux d’avoir une job dans le contexte actuel. Et pas juste un travail, mais une véritable passion pour le photographe qui nourrit en plus un site personnel de ses clichés. « J’essaye d’être réactif aux points de presse du premier ministre et je cherche aussi des façons d’illustrer l’ambiance de Montréal au quotidien », raconte le photographe, qui manque rarement d’inspiration. « Je n’ai pas de pression de mon employeur. Il me fait confiance », résume-t-il.

À l’heure où l’on tergiverse sur le déconfinement, les photojournalistes restent là, dans l’ombre, écrivant l’Histoire à leur façon.
Lâchez pas collègues, de Montréal et de partout à travers la province.
Vous êtes notre mémoire.
-30-
Diplômé en littérature, Hugo Meunier s’est tourné vers le journalisme pour payer son loyer. Après avoir couvert les conflits au Liban et en Afghanistan, il s’est découvert une passion pour le journalisme d’immersion.
Il a été journaliste à La Presse, puis Directeur de la production de contenus numériques au Journal de Montréal. Il est maintenant journaliste à Urbania.
Les propos reproduits ici n’engagent que l’auteur. La FPJQ ne cautionne ni ne condamne ce qui est écrit dans ces textes d’opinion.

.jpg)